Hormonisation et chirurgie du genre : un livre affirme que la médecine oublie son serment de ne pas nuire
- La Petite Sirène

- il y a 2 jours
- 12 min de lecture
Hormonización y cirugías de género: un libro afirma que la medicina está olvidando su juramento de no dañar - Claudia Péro - 19 avril 2025 - Infobae
Soumis à des idéologies identitaires, certains professionnels négligent leur mission humanitaire essentielle. Des personnes saines, même mineures, sont transformées en malades à vie, stérilisées, voire privées d'une vie sexuelle épanouie.
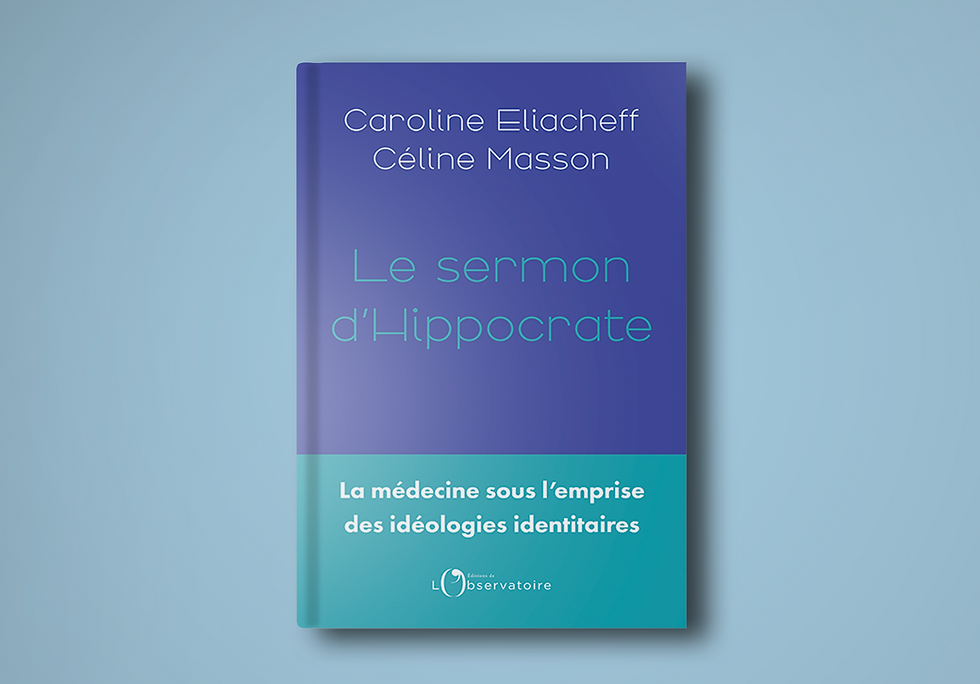
En écrivant La fabrique de l'enfant transgenre en 2022 - inquiètes de la rapidité avec laquelle une partie de la médecine orientait les enfants vers un traitement hormonal pour changer de sexe - la pédopsychiatre française Caroline Eliacheff et la psychanalyste Céline Masson croyaient - « naïvement », disent-elles aujourd'hui - qu'« un consensus se formerait sur la question de l'enfant ». Hormonisation et chirurgie du genre : un livre affirme que la médecine oublie son serment de ne pas nuireSoumis aux idéologies identitaires, certains professionnels négligent leur mission humanitaire essentielle. Des personnes saines, même mineures, sont transformées en malades à vie, stérilisées, voire privées d'une vie sexuelle épanouie.
Au contraire, c’est l’inverse qui s’est produit : elles ont été boycottées, annulées et insultées. Cela ne les a pas découragées, comme le montre leur nouveau livre : Le sermon d’Hippocrate. La médecine sous l’emprise des idéologies identitaires (El sermón de Hipócrates. La medicina bajo el dominio de las ideologías identitarias), qui n’a pas encore été traduit en espagnol.
Quand elles parlent de « ce qui concerne les mineurs », les autrices font référence à une situation analogue à celle de l’Argentine en matière de traitement des enfants et adolescents qui se déclarent trans, c’est-à-dire qui affirment appartenir au sexe opposé à celui de leur naissance. Dans les deux pays, la législation est extrêmement permissive, et les services de santé qui administrent des traitements à base de bloqueurs de puberté à des enfants de 10 ou 11 ans sont nombreux (afin d’interrompre le développement sexuel), suivis ensuite d’un traitement hormonal croisé pour développer les caractères sexuels du genre souhaité — à partir de 15 ou 16 ans environ —, et enfin, d’interventions chirurgicales (mastectomies, hystérectomies, castrations, fabrication de pseudo-organes sexuels, etc.).
« Nous n’avions pas pris la mesure de l’ampleur de la présence prosélyte [des associations militantes] (et/ou de leurs défenseurs) dans tous les rouages de l’État, dans les partis politiques, à l’université, dans les ministères (notamment ceux de l’Éducation et de la Santé), dans les municipalités, ainsi que dans d’autres organismes dépendants de l’État (…) et bien entendu dans les services de santé dédiés à cette question », réfléchissent aujourd’hui Eliacheff et Masson, à la lumière des attaques qu’elles ont subies après la parution de leur premier livre.
La presse, écrite comme audiovisuelle, a elle aussi été investie par les discours trans-affirmatifs, avertissent-elles. C’est-à-dire, l’idée selon laquelle il suffirait de l’expression d’une volonté individuelle pour engager une transition de genre, y compris chez des mineurs ou des personnes souffrant d’autres comorbidités.
La transition de genre est présentée comme « un voyage à la rencontre de soi », ou comme une thérapie de prévention du suicide, tandis que les effets secondaires de ces traitements, ainsi que leur caractère irréversible dans la plupart des cas, sont dissimulés ou minimisés. Les bloqueurs de puberté sont comparés au bouton pause d’un lecteur vidéo : on interrompt le développement pendant quelques années, puis on le relance sans problème…
Dans ce premier livre (février 2022), elles analysaient la croissance exponentielle des cas de dysphorie de genre chez les adolescents, en particulier chez les filles — un fait que les promoteurs de ces pratiques relativisent. Ce phénomène se répète dans d’autres pays, y compris le nôtre, comme le confirment les chiffres de cas recensés par l’association MANADA (Mères de Filles et d’Adolescentes avec Dysphorie Accélérée).
Dans leur nouveau livre (février 2025), Eliacheff et Masson s’interrogent sur les raisons pour lesquelles tant de médecins mettent en œuvre des méthodes nocives pour ces mineurs, dénoncent l’abandon de la responsabilité adulte — toujours au nom de l’autonomie progressive — et proposent une alternative au traitement actuellement proposé aux adolescents souffrant de dysphorie de genre, en suggérant une autre définition du malaise.
La majorité des adolescentes traitées comme trans « ne remplissent pas les critères diagnostiques de la dysphorie de genre », affirment-elles. Il y aurait un surdiagnostic qui masque d’autres troubles.
Dans la postface du livre, le professeur Didier Sicard, professeur honoraire de médecine interne à l’Université Paris Cité, qui a présidé pendant près de dix ans le Comité consultatif national d’éthique, souligne que la médecine est en train de cesser d’être un humanisme, encouragée par une financiarisation croissante au détriment du soin.
La modification de l’humain est une activité bien plus lucrative que le soin, affirme-t-il. Comme en Argentine, où ces traitements coûteux sont pris en charge dans le cadre du Plan Médical Obligatoire (PMO), en France aussi, la couverture intégrale des transitions constitue « un facteur évident d’encouragement : si c’est remboursé, c’est que c’est sûr », dit ce professeur.
Sicard énumère certains effets secondaires possibles d’une hormonothérapie sans indication médicale chez des corps adolescents : cancer du foie, méningiomes, déminéralisation osseuse, stérilité, absence de vie sexuelle. En somme, dit-il, ces enfants deviennent « du matériel de laboratoire », ce qui semble être la dernière des préoccupations d’une médecine déshumanisée. Le seul argument avancé par les médecins pour justifier ces traitements est qu’ils visent à soulager une souffrance. Une souffrance qui est psychique, mais que l’on ne cherche pas à traiter d’abord sur ce plan-là. À la place, on a recours à des thérapies destinées à d’autres syndromes endocriniens, à l’intersexualité de naissance (hermaphrodisme), à la puberté précoce, etc. Mais dans ces cas-là, il s’agissait de la véritable fonction de la médecine : corriger un désordre, non en provoquer un.
Aujourd’hui, de nombreux médecins mettent de côté le principe essentiel du primum non nocere (d’abord, ne pas nuire).
Conscient que ces pratiques sont traversées par le débat idéologique entre gauche et droite, Didier Sicard souligne que « assimiler la défense des enfants et des adolescents à un comportement d’extrême droite est tout simplement incroyable ». La médecine, affirme-t-il, ne doit pas se soumettre aux modes du moment.
Le livre d’Eliacheff et Masson dénonce une activité médicale qui frôle l’illégalité, car elle répond à des intérêts économiques, et attire l’attention sur le danger que cela représente pour l’avenir des enfants et des adolescents.
Lorsque la question des mineurs trans arrive dans les médias, les services qui promeuvent ces traitements hasardeux affirment prendre toutes les précautions nécessaires avant d’intervenir — ils vont jusqu’à nier qu’ils traitent des mineurs —, mais les témoignages des patients et de leurs familles contredisent ces affirmations et attestent de traitements hormonaux précoces, même en présence d’autres troubles concomitants à la dysphorie. C’est un autre parallèle avec ce qui se passe dans notre pays.
Eliacheff et Masson dénoncent dans leur livre — et cela vaut aussi pour l’Argentine — l’absence d’information suffisante donnée aux patients et à leurs familles concernant les effets secondaires des traitements, ainsi que l’existence d’alternatives telles qu’une psychothérapie. Elles recommandent également une attente prudente, car la majorité des dysphories survenant brutalement à l’adolescence disparaissent avec le temps. Les autrices sont convaincues que, « bien que leur souffrance pubertaire soit réelle, [ces adolescents] ne sont pas trans (même si une minorité pourra l’être et entreprendre sa transition plus tard) ».
Les personnes transsexuelles ont toujours existé, disent-elles, « dans toutes les civilisations, de façon très minoritaire ». Comme toutes les minorités, elles ont droit à la non-discrimination. Mais aujourd’hui, « leur posture victimaire a servi de cheval de Troie » à « un militantisme de genre qui tente de s’imposer à l’ensemble de la société comme un nouvel ordre moral ».
La majorité des mineurs résolvent seuls leurs questionnements liés au genre à l’âge adulte, à condition de ne pas avoir entamé une transition, ni sociale ni médicale — un constat qui souligne, selon elles, l’irresponsabilité qu’il y a à promouvoir des transitions précoces chez les enfants et les adolescents.
Mais les professionnels qui prônent la prudence, qui suggèrent par exemple une psychothérapie exploratoire, sont systématiquement qualifiés de transphobes, maltraitants, réactionnaires, charlatans et, bien entendu, d’ultra-droite (comme le souligne Sicard).
Les associations trans exigent que les médecins acceptent sans délai ni condition l’identité de genre d’une personne, même mineure, et que les transitions médicales dépendent de sa seule volonté. Elles veulent également imposer que les approches psychologiques soient uniquement affirmatives (c’est-à-dire : aller dans le sens du patient), que la transidentité soit dépathologisée (ne pas orienter vers une thérapie sauf à la demande expresse de la personne), et que les mineurs aient le droit à la transition hormonale et à la chirurgie.
Cette réalité se répète dans presque tous les pays occidentaux. Cependant, ceux qui ont été pionniers en la matière ont commencé à revoir leurs protocoles : la Finlande, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni ont restreint les traitements appliqués aux mineurs. Il en va de même dans 24 États des États-Unis.
Mais, affirment les autrices, de nombreux services médicaux continuent à suivre les directives de la WPATH (World Professional Association for Transgender Health) les yeux fermés, alors que ses postulats sont que l’enfant sait à quel genre il appartient et ne changera pas d’avis, qu’il n’existe pas de contagion sociale, et que l’augmentation des cas est due à la libération de la parole.
La WPATH affirme que la transition sociale favorise le développement psychique, que les bloqueurs de puberté sont réversibles, et que refuser un traitement à une personne qui se dit trans augmente le risque de suicide, effectivement très élevé au sein de cette population. Mais Eliacheff et Masson soulignent qu’aucune preuve ne démontre une corrélation entre transition médicale et réduction de ce risque, souvent brandi comme une menace face aux réticences des parents ou des thérapeutes.
En Argentine, le même phénomène se produit. Les avertissements lancés par les systèmes de santé des pays qui sont revenus sur ces traitements pour protéger les mineurs contre ces thérapies invasives, irréversibles et loin d’être anodines sont ignorés. Par exemple, le rapport Cass, fruit de quatre années de travail d’une équipe indépendante de spécialistes au Royaume-Uni, a conclu que les traitements de transition sont encore expérimentaux. À la suite de ce rapport, le gouvernement britannique a suspendu l’administration de bloqueurs et d’hormones aux mineurs. Pourtant, ce rapport n’a pratiquement pas été relayé ni débattu en Argentine, même parmi les responsables de cette politique.
Le 6 février dernier, dans notre pays, le gouvernement national a promulgué le décret de nécessité et d’urgence (DNU) 62/2025, interdisant les traitements hormonaux et les chirurgies de changement de sexe chez les mineurs de moins de 18 ans.
De manière surprenante, la Société Argentine de Pédiatrie (SAP) a réagi en exprimant sa « profonde préoccupation », dans un communiqué dans lequel elle cite les droits de l’enfant, évoque « l’autonomie progressive » du mineur, qualifie la Loi d’identité de genre (n° 26743) de « progrès », qualifie le rapport Cass de « document controversé », et réitère l’ensemble de la doctrine justifiant ces traitements, à savoir que « l’absence d’accès à une santé intégrale augmente la prévalence de la dépression, de l’anxiété et des tentatives de suicide », tandis que les traitements de transition « améliorent significativement la qualité de vie et le bien-être ».
Elle conclut en évoquant ses plus de 20 000 membres, ce qui amène à se demander si le contenu de ce communiqué de la direction de la SAP est réellement partagé par tous ces pédiatres à travers le pays.
On notera le euphémisme « accès à la santé intégrale », alors qu’il s’agit en réalité de bloquer la puberté, d’administrer des hormones du sexe opposé à des adolescents, et même de réaliser des chirurgies mutilantes chez des mineurs.
Eliacheff et Masson soulignent justement l’usage d’euphémismes auquel ont recours ceux qui pratiquent une médecine au service d’une idéologie. Par exemple, « torsoplastie » pour désigner l’ablation des seins.
LOBOTOMIE ET STÉRILISATION
Ces praticiens proposent des « solutions miracles, en exploitant l’immaturité affective, souvent associée à des troubles psychiques chez les jeunes, ainsi que la détresse des parents », affirment les autrices, qui citent également d’autres exemples de thérapies ayant causé plus de tort que de bien, comme la lobotomie. Cette méthode, inventée par un neurologue portugais, consistait à sectionner les fibres reliant le lobe frontal au reste du cerveau, pour traiter des maladies psychiatriques.
Aujourd’hui, cela scandalise, cela paraît délirant, pourtant António Egas Moniz reçut le prix Nobel de médecine en 1949 « pour la découverte de la valeur thérapeutique de la leucotomie dans certaines psychoses ».
La méthode fut introduite aux États-Unis par le neurologue Walter Freeman, qui s’associa à un chirurgien et réalisa des milliers de lobotomies, y compris celle qui laissa une sœur de John F. Kennedy dans un état quasi végétatif.
Tous les médecins n’y ont pas cru, et la méthode fut l’objet de vives critiques dès le départ, mais la lobotomie a continué à être pratiquée jusqu’à la fin des années 1970.
« Les médecins se croient dans le camp du bien, disent Eliacheff et Masson, au point d’ignorer toutes les alertes qui remettent en cause leurs résultats, leur confort, leur notoriété et les pouvoirs acquis. »
Elles évoquent également le cas de l’hystérie, une maladie nerveuse massivement féminine, traitée à la fin du XIXe siècle avec des méthodes aussi brutales que l’ablation du clitoris ou l’hystérectomie. Comme pour la lobotomie, certains professionnels avaient déjà dénoncé ces pratiques comme de simples mutilations, et préconisé un traitement psychologique de ce trouble.
Au XXe siècle, un glissement idéologique s’est produit, préviennent les autrices : l’hystérie a commencé à être perçue comme un problème génétique plutôt qu’organique. La stérilisation était censée empêcher sa transmission. C’était l’émergence des théories eugénistes.
« Si l’eugénisme a concerné les hystériques du XIXe siècle, le transhumanisme du XXIe n’est pas sans lien avec les demandes actuelles de changement de sexe », affirment Eliacheff et Masson.
Elles citent Pierre-André Taguieff, selon qui :
« Eugénistes et transhumanistes partagent une idée-force : les croyances religieuses traditionnelles doivent être remplacées par une nouvelle foi centrée sur le désir d’améliorer la vie des générations futures à travers une reconfiguration de la nature humaine. »
N’y a-t-il pas un parallèle, demandent-elles, entre retirer les seins pour soulager une souffrance psychique et castrer les hystériques, comme le croyait le gynécologue allemand Alfred Hegar, qui affirmait que « l’élimination des glandes génitales supprimait le mal » ?
Le serment d’Hippocrate oublie le principe de “ne pas nuire” ; on transforme une personne physiquement saine en patient à vie, stérile et souvent atteint d’anorgasmie.
UNE NOUVELLE APPROCHE CLINIQUE
Eliacheff et Masson affirment que la transversion repose sur une idéologie qui implique une rupture avec la réalité (la différence des sexes) et un changement de paradigme.
Ceux qui la promeuvent cherchent à convaincre la population qu’il est possible de changer de sexe, en exerçant une pression émotionnelle, en verrouillant le débat et en isolant ceux qui contestent.
C’est pourquoi elles soutiennent que l’augmentation des cas ne résulte pas de la libération de la parole, mais de la libération de l’offre.
Dans une logique woke, affirment-elles, parler de sexe biologique devient presque un délit, une violence contre la communauté LGBTQIA+. La critique est assimilée à une insulte. Toute différence devient une injustice à combattre. Même la biologie est accusée d’être discriminatoire, intolérante, voire transphobe.
Eliacheff et Masson ne théorisent pas dans l’abstrait : elles ont suivi et suivent des cas cliniques. Fortes de cette expérience et de leurs recherches, elles ont élaboré une nouvelle proposition clinique pour le traitement de la dysphorie chez les adolescents.
Elles proposent d’utiliser l’expression Angoisse de Sexuation Pubertaire (ASP) pour désigner ce trouble. On peut le traduire comme Angoisse liée au développement sexuel pubertaire.
Les symptômes sont : angoisse intense et persistante, pouvant aller jusqu’à la crise de panique à l’apparition des caractères sexuels secondaires ; rumination, honte du corps, stratégies pour cacher ces caractères, peur, tristesse, culpabilité, dévalorisation, crainte de l’agression liée à ce développement (moqueries, remarques), peur de la sexualité adulte, sautes d’humeur, colère.
Ces symptômes peuvent être aggravés par des comorbidités : troubles alimentaires, anxiété sociale, dépression, antécédents de violence et/ou traumatisme, TDA/H, troubles du spectre autistique.
Ces jeunes, affirment-elles, sont une proie facile pour un discours médiatique et parfois universitaire qui offre une solution rapide et radicale :
« Si tu te sens mal dans ton corps, c’est que tu es trans. »
Un autodiagnostic qui renforce le rejet du corps et l’impossibilité de s’adapter à ses transformations.
Ce que promeut l’activisme transgenre, expliquent-elles, c’est l’affirmation d’être né dans le mauvais corps, le refus de toute exploration de l’origine du mal-être, et la menace du suicide pour obtenir des bloqueurs de puberté.
L’approche qu’elles proposent face à l’ASP est tout autre :
Pas d’hormones avant la majorité
Évaluation complète (individuelle, familiale, sociale)
Traitement psychothérapeutique, éventuellement psychopharmacologique si nécessaire
Le livre s’ouvre et se clôt sur un récit à deux voix, en première personne, d’un cas de dysphorie de genre accélérée : une jeune fille et son père racontent trois années vécues entre ses 13 ans, lorsqu’elle a cru être née dans le mauvais corps, et ses 15 ans, quand elle s’est réconciliée avec son sexe biologique.
Le site LGBT qu’elle a consulté, raconte Lou (nom fictif), « ne soutenait que l’idée que si un garçon ou une fille ne rentre pas dans les stéréotypes de genre, alors il ou elle est forcément trans ». Elle aurait préféré qu’on lui dise :
« C’est normal à cet âge de se sentir mal à l’aise dans son corps, qu’il n’y a rien de mal à être un peu masculine, à explorer d’autres styles. »
Elle regrette que son père ait été dénoncé à la justice pour avoir insisté sur le fait qu’il avait une fille et non un fils. Cela se produit également en Argentine.
À 15 ans, dit-elle, elle n’avait pas conscience des risques ni de l’irréversibilité de certaines décisions.
L’approche trans-affirmative pousse des jeunes en grand mal-être à faire des choix qui transformeront leur corps de manière irréversible.
Aujourd’hui majeure, Lou adresse un message aux jeunes qui vivent la même détresse qu’elle :
« Il faut comprendre qu’il existe d’autres façons de vivre avec cette dysphorie, de la soulager, voire de la surmonter. »
Et elle ajoute :
« Il faut encourager les jeunes à explorer leur identité et leur corps, plutôt qu’à le modifier pour correspondre aux stéréotypes du sexe opposé. »
Trad. Chat GPT et DeepL







Comments